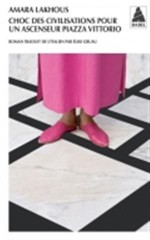21 juillet 2014
La 55e des 101 Choses
Le WLF Think Tank est une bande de traducteurs + une illustratrice qui ont regroupé, dans un livre intitulé 101 Things a Translator Needs to Know, 101 conseils principalement destinés aux inconscients aventuriers novices qui voudraient se lancer dans la traduction.
Ce comité de réflexion est en cela plus ambitieux que ce modeste blog qui, de temps à autre, extirpe de sa torpeur un Jeune Traducteur Inexpérimenté pour lui jeter en pâture quelques bribes de sa vaste expérience, dans le but charitable de combler ses lacunes et d'en inciter de plus assis mais moins compétents à changer de boulot pour lui faire de la place.
La 55e des 101 Choses qu'un traducteur doit savoir s'intitule Mind the Gap, ledit gap étant celui qui sépare nos diverses cultures (pour les non-anglicistes : gap a souvent le sens d' « écart » ou de « fossé », au propre comme au figuré, et Mind the gap est l'équivalent de notre « Attention à la marche » dans le métro). Cet article du livre est consacré à la ponctuation, qui a effectivement ses règles propres d'une langue et d'un pays à l'autre, histoire de compliquer la vie du traducteur comme s'il n'en bavait pas assez comme ça.
En guise de substitut français à Mind the gap, je ne trouve pour le moment rien de mieux que :
– Le point d'horreur du traducteur
ou
– Traduire des points ?!...
ou
– Un point fait tout
J'avoue au passage que cet article de 101 Things m'a donné l'occasion d'apprendre que des signes comme les guillemets ou les parenthèses font partie de la ponctuation. Sur le moment, j'ai cru avoir découvert un gap, en pensant que punctuation recouvrait peut-être un sens plus large qu'en français ! (« Viens m'apprendre mon taf après ça », marmonne le Jeune Traducteur Inexpérimenté mais prompt au triomphe et fort de son bac +12 en sciences des langues.)
L'article 55 s'achève sur trois phrases qui ne pouvaient que me mettre en joie, pour mieux me plonger ensuite dans des cogitations que l'adjectif « laborieuses » exprime moins bien que l'expression imagée sur laquelle joue la première phrase :
« Punctuation can be a pain in the asterisk.
You can quote us on that.
Just make sure you use the right quotation marks. »
La bande d'auteurs du livre nous autorise à la citer, à condition d'employer les guillemets appropriés. « Citez-nous si vous voulez mais citez-nous à point nommé. », adapterais-je tant bien que mal, car nous avons affaire là à un deuxième jeu de mots. Ou bien, en m'éloignant du sujet pour rappeler notre cher droit d'auteur si souvent passé à la trappe : « Citez-nous si vous voulez mais n'oubliez pas de nous citer. »
Dont acte.
(« Don’t act », prétendrait un correcteur orthographique paramétré pour l’anglais et commettant par là un lourd contresens sur l’objet même de ce livre qui, à l'inverse, incite le lecteur à passer à l'acte traductif, mais en connaissance de cause.)
Voici, après quelques remue-méninges – vive les trajets en train, propices à ce genre de divertissements ! –, quelques traductions pour la première phrase :
– Sans ponctuation, point de salut. Ni d’interrogation ? Ni d’exclamation ! Ni de suspension…
– La ponctuation est un point d’interrogations multiples.
– La ponctuation : points trop n’en faut.
– La ponctuation ? Allez trouver le point génial...
À vous de relever le défi des auteurs et de vous amuser à trouver d’autres idées de traduction ! Ce qui reviendra – paradoxe – à relever le niveau de mes suggestions tout en en abaissant le niveau de langue (vous me suivez ?) afin qu'il ne soit ni trop grossier, ni trop raffiné, ce à quoi je ne suis pas parvenue.
Bref, à vous d'en avoir bientôt plein l'ast... d'être bientôt tout endoloris de l'astérisque.
Que le Lecteur qui repérerait dans ce billet une erreur de ponctuation ou autre n'hésite pas à me la signaler !
Sur un sujet proche, ce blog s'est déjà fendu d'un petit billet.
© WLF 101 Publishing 2014
Auteurs : Paul Boothroyd, Carmelo Cancio,Chris Durban, Steve Dyson, Andy Evans, Janet Fraser, Catherine Anne Hiley (illustratrice), Ian Hinchliffe, Inga-Beth Hinchliffe, Hugh Keith, Terence Lewis, Bill Maslen, Terry Oliver, Nick Rosenthal, Ross Schwartz,
Rannheid Sharma, John Smellie, Lois Thomas
Compilé et révisé par Ian Hinchliffe, Terry Oliver, Ros Schwartz
20:34 Publié dans À travers mots, Ceci n'est (vraiment) pas d'la critique littéraire | Commentaires (0) | Lien permanent
05 juillet 2014
Elle voit des traducteurs partout (6) - Et susceptibles, avec ça.
Une enquêtrice, tentant d'éclaircir les circonstances d'un homicide, demande à un traducteur ce que signifient quelques mots inscrits sur des bouts de papier retrouvés dans la poche de la victime. Entre crochets : analyse de l'implicite par votre servante mais c'est juste pour le plaisir du mauvais esprit.
Elle repensa aux petits bouts de papier froissés en boule, avec des mots en arabe dont elle aurait bientôt la traduction. Cela ne devait avoir aucune importance, mais elle devait quand même s'en assurer.
Le traducteur répondit à la troisième sonnerie.
[Occupé à trier ses cocottes en papier, le gratte-papier feint d'être débordé et absorbé par sa tâche d'une extrême importance, d'où son retard à la détente, calculé à la sonnerie près.]— Ah ! ça n'a pas été facile à déchiffrer..., prévint-il.
[Il en remet une couche, au cas où on douterait de sa qualification et des textes pointus sur lesquels il travaille. D'une sensibilité exacerbée, il perçoit que son interlocutrice n'est pas convaincue de l'intérêt de la mission qu'elle lui a confiée.]— Mais vous avez quand même réussi à comprendre ce qui était écrit ? demanda Frederika, curieuse.
— Oui, bien sûr, répondit le traducteur, qui sembla presque vexé par la question.
[Et bouffi d'amour-propre, avec ça.]Frederika se mordit la lèvre. Zut ! Que de susceptibilités à éviter de froisser...
Suit le décryptage des mentions sur bouts de papier.
Ce collègue qui gagnerait de voir ses mérites plus justement reconnus fait une apparition dans :
La Fille au tatouage
Kristina Ohlsson
Traduit du suédois par Hélène Hervieu
J'ai Lu, 2012 (page 113)
11 mars 2014
Once upon a dog
Un chien qui parle, c'est assez normal.
Mais celui-là est trilingue. C'est déjà plus fort. Il parle portugais, anglais et français. Et par-dessus le marché, c'est un chien penseur (vous imaginez la sculpture, si Rodin l'avait connu) :
E eu fiquei a pensar:
– Mas nós pensamos porque temos ideias, ou temos ideias porque pensamos?
– Estás a ficar filósofo, disse-me o cão.
Et j'ai continué dans mes pensées :
– Est-ce que nous pensons parce que nous avons des idées, ou bien nous avons des idées parce que nous pensons ?
– Tu deviens philosophe, dit le chien.
And I continued my train of thought:
'Do we think because we have ideas, or do we have ideas because we think?'
'You're becoming a philosopher,' said the dog.
Le reste du conte, qui plaira aux philosophes enfants, adultes ou chiens est à découvrir dans un livre en feuilles délicatement conçu et illustré. Ce joli objet est publié par une maison d'édition dont le nom invite à l'évasion, même si on reste à la niche : Vagamundo.
Nuno Júdice
Uma história de cão
Éditions Vagamundo, Pont-Aven, 2013
Images : Mathieu Schmitt
Version française : Cristina Isabel de Melo
Version anglaise : Graham macLachlan
19:36 Publié dans Ceci n'est (vraiment) pas d'la critique littéraire | Commentaires (0) | Lien permanent
22 juin 2013
Elle voit des traducteurs partout (2) - Chez San-A
« Je faisais des traductions pour payer la location de notre résidence secondaire. »
Argh + soupir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas croisé ce cher poncif qui associe le métier de traducteur à un boulot accessoire, tout juste bon à arrondir les fins de mois. J'en suis encore à m'demander ce qu'un traducteur peut bien trouver comme job d'appoint, lui, pour se payer son cabanon du week-end.
L'individu qui profère le cliché de service raconte sa vie d'avant le jour où il a plaqué Bobonne, sa vie bourgeoise de prof de philo et ses préoccupations bassement matérielles pour s'installer sous les ponts. Car il s'agit d'un clodo, de l'espèce authentique et à vocation. Il faut dire que ça se passe dans les années 1970.
Ça se passe dans les années 1970 et dans Les Con, de San-Antonio, que j'ai entrepris de re-relire, allez savoir pourquoi – le fameux et récurrent besoin d'identification, sans doute. Il a eu un coup de mou, le San-A, en bas de la page 172... Pourtant, le reste de l'envolée lyrique du sieur clodo vaut son pesant de cacahouètes. Il faut dire que le Boudu vient d'être sauvé des eaux par le Béru. L'un engueule copieusement l'autre pour l'avoir extrait de sa liberté pouilleuse des bords de Seine. Brèfle, si vous connaissez le Gravos, vous l'imaginez (la Seine).
La bande de Con est au singulier dans le titre du polar car il s'agit de gens affublés du même et difficile à porter patronyme. Un mystérieux conicide les dégomme les uns après les autres pour leur apprendre à hériter d'un célèbre et richissime Con mourant, qui a testé en leur faveur. Je vous replace en contexte la phrase qui tue :
« Des années à croire au Système, mes pleutres. A l'estimer irréversible. A gauchifier sur la pointe de l'urne, pour se donner l'impression qu'on va changer quelque chose sans toucher à rien. [...] Ils se déclarent libres, et ils ont des épouses et des monstres ! Ah, les carcans vivants ! Un jour, je leur ai tourné le dos pour toujours. J'étais professeur de philosophie, messieurs les inconsistants. [...] Je rêvais de la Légion d'Honneur. Je croyais qu'il avait existé de grands hommes et qu'il en existait encore. Je croyais que ma femme m'aimait autant que je l'aimais. [...] Je soignais mon foie. Je faisais des traductions pour payer la location de notre résidence secondaire. Je me torchais le cul avec du papier de première qualité, etc. »
On observera que notre phrase qui tue est bien entourée !
Les Con
San-Antonio
Fleuve noir
1973

Pour la route, la pensée du jour.
Elle est elle aussi extraite des Con, qui intercale un polar,
un essai intitulé Con Magazine et quelques encarts
bien sentis sur un sujet universel et inépuisable :
« Le pauvre con croit qu'inspirer la pitié est un privilège. »
20 mai 2013
Elle voit des traducteurs partout (1) Choc des civilisations pour un ascenseur...
N'y a-t-il pas quelque chose de bêbête à apprécier un film, un livre simplement parce qu'on se reconnaît dans les personnages ? Telles ces ex-nymphettes qui s'identifient aux déjà-quasi-ex-nymphettes mises en scène par tel réalisateur, en soupirant d'admiration parce qu'elles retrouvent chez les protagonistes les affres de leur adolescence évaporée : « C'est tellement vrai ! » Ou pire, tels ces citoyens moyens scotchés devant un feuilleton qui reflète, paraît-il, leur quotidien, en à peine moins banal.
Je préfère largement ces œuvres universelles, dont on n'a rien en commun avec les héros, puisqu'elles peuvent se situer aux antipodes ou presque, et même pas à notre époque. Rien en commun... ou plutôt, si : l'essentiel. Exemple : Dersou Ouzala (Akira Kurosawa, 1975 - J'avoue ne pas avoir lu le livre éponyme de Vladimir Arseniev.). Le lien avec ces êtres simplement humains est évident, profond, et tellement plus attachant que les peines de cœur de Machine à la plage. Mais bon, admettons que je n'aie pas eu les dispositions nécessaires pour faire ex-nymphette. Quoi qu'il en soit, il doit y avoir du besoin d'identification là-dessous.
Parfois, c'est non pas dans la fiction qu'on (enfin, moi, quoi) l'assouvit, ce bêbête besoin. C'est dans l'expression d'idées. Car en plus, on (toujours moi, quoi) a alors la satisfaction assez minable d'être confortée dans son avis, le seul, l'unique possible ! On se ravit par exemple à lire certains collègues, quand ils prennent la souris pour écrire leurs propres mots au lieu de traduire ceux des autres. On se réjouit tout en faisant aveu d'impuissance : « C'est exactement ce que je pense, mais si bien exprimé ! Je n'aurais trouvé que des mots maladroits pour le dire, qui auraient détourné ou exagéré ma pensée. » Idem à l'écoute de certains précieux artistes.
De là à se voir soi-même représentée, à s'exclamer in petto « Mais c'est moi, ça ! »... il y a une limite, que j'ai franchie pour le coup, en lisant dans un roman le passage suivant. Ce n'est plus du bêbête, c'est de l'idiotie caractérisée, cette identification à outrance :
« "Toi, tu es un toxicomane d'un genre très particulier, ta drogue, c'est la pizza !" Je n'ai pris conscience de mon avidité pour la pizza que très récemment. C'est sûr que la pizza est mon plat préféré, je ne peux pas m'en passer. À présent, tous les symptômes de la dépendance sont évidents. La pizza s'est mêlée à mon sang et me voici devenu un alcoolique de la pizza au lieu du vin. Bientôt je me fondrai dans la pâte et deviendrai pizza à mon tour. »
Je vous passe l'extrait sur la manie de nourrir les pigeons, mais c'est juste pour ne pas aggraver mon cas.
Je vous entends maugréer « Bravo. Tu as réussi à nous dissuader de le lire, ton bouquin. Ta carrière de critique littéraire est faite. Si tu crois qu'à la perspective de te retrouver à chaque page te goinfrant ou, qui pis est, donnant à des pigeons l'occasion d'en faire autant, on va se précipiter pour l'acheter... »
M'étonne pas de vous. Et si je vous disais que quelque part dans ce petit livre, un traducteur a le beau rôle ? (Non, plus guère de rapport avec mon portrait de traductrice pizzamane à ce stade, rassurez-vous, je n'ai pas poussé l'assimilation jusque-là.) Des traducteurs, dans les bouquins, on en rencontre pas mal, tout compte fait. Mais en général, ils sont plutôt antipathiques ou en tout cas pas attachants du tout. Ou bien, l'auteur ne leur affecte ce métier que parce qu'il lui faut un glandeur, disponible aux heures de bureau pour en faire l'instrument de son imaginaire. Là, non. On tient un véritable héros. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous dévoiler la fin, car s'il ne s'agit pas d'un roman policier, l'intrigue tourne cependant autour d'un meurtre, dont le coupable est à identifier.
Et surtout, c'est un livre touchant sur le personnage, universel par-dessous tout, de l'étranger (nan, ce n'est pas un texte militant-chiant, je vous vois venir). Parmi tous les protagonistes qui apportent chacun sa vision plus ou moins biaisée de la réalité, en témoignant tour à tour, avec leur expression propre (ce qui rend le roman intéressant aussi pour le style), le plus mal intégré dans le pays n'est pas forcément celui qu'on croit.
Voilà pourquoi je vous recommande – si tant est que ce blog ait à prescrire quoi que ce soit – la lecture de cet ouvrage, malgré son titre, pas plus « vendeur » que ce pitoyable billet. Rien à redire sur sa traduction, pour autant que je puisse en juger.
Amara Lakhous
Choc des civilisations pour un ascenseur Piazza Vittorio
Traduit de l'italien par Élise Gruau
Babel, Actes Sud, 2007
Merci à N. qui me l'a offert ! Et qui, en visite à Rome, est allée exprès voir la Pizza Piazza Vittorio. L'histoire ne dit pas si N. a donné à manger aux pigeons.
29 décembre 2012
Marcher - Partir ?
« Rien ne ressemble plus à un rêve
qu’un voyage en car de nuit dans un pays étranger. »
Terje Sinding m’a offert un livre de Tomas Espedal, qui s’intitule Marcher (ou l’art de mener une vie déréglée et poétique).
La sédentarité ne convient pas au narrateur. Sans doute être enfermé entre quatre murs empêche-t-il cet écrivain de penser comme il le voudrait, lui qui ne pense jamais mieux qu’en marchant, surtout en montagne, et pour qui « marcher, c’est le contraire d’habiter ». N’y tenant plus, il part pour des mois de semi-vagabondage, dans un premier temps à travers son pays, la Norvège. Au fil du livre, il racontera aussi d’autres de ses échappées, notamment en France, sur les traces de Rimbaud, de Satie, de Giacometti et de son Homme qui marche.
L'Homme qui marche et l'enfant
Sculpture d'Alberto Giacometti,
fondation Maeght
Photo © Louis-Paul Fallot
Convoquant Rousseau, Chatwin et bien d’autres, l’auteur définit un genre littéraire : le livre de marcheur. Mais ce roman marche aussi vers le cœur de l’écriture. Un paradoxe se dessine : si la marche favorise les pensées, écrire oblige à lutter contre elles. La lutte et la souffrance sont aussi celles du corps, à cause de la faim, du froid, des ampoules. Pourtant, marcher est également un moyen de se purifier. Et c’est le bonheur de la solitude, en une phrase du traducteur qu’on voudrait avoir formulée soi-même :
« Jamais je ne me sens moins esseulé qu’en étant seul. »
Le narrateur quitte son cher isolement (où il croise toutes sortes de personnages) pour rejoindre en Grèce son ami et habituel compagnon de marche, Narve. L’évocation d'un de leurs souvenirs communs, une représentation du Songe d’une nuit d’été, en plein air et justement lors du solstice d’été, à l’occasion d’une précédente randonnée en Norvège, vaut à elle seule de lire le roman.
Si Narve est équipé d’un seyant pantalon de rando couleur fluo, le narrateur, assez peu conforme à la dégaine du Vieux Campeur, se balade sur les chemins escarpés, d’un bout à l’autre de l’Europe, en costard à fines rayures et Doc Martens. Aux deux compères qui sont là pour des mois et ont quasiment tout quitté pour pénétrer des régions inconnues, il arrive de croiser leurs contraires, « ces types pourvus d’un sérieux mélange de témérité et de bêtise, les pires qualités pour entreprendre un voyage ». De ces « idiots itinérants », j’ai croisé avec perplexité un bon nombre de spécimens lors de mes propres vadrouilles, en me demandant pourquoi ils partaient pour de si longs périples, si c’était pour rester cloîtrés ou presque, en territoire bien rassurant et entourés de leurs clones, dans les auberges de jeunesse du continent écumé. De quoi rêvent-ils ? « Du plaisir de rentrer à Sydney, de reprendre des études et d’épouser la fille des voisins. » En Turquie, l’expédition de Narve et du narrateur prendra fin, vaincue par le mal du pays.
Ajoutons qu’en chemin, les deux zigs sifflent une impressionnante quantité de whisky, ouzo, raki et autres substances alcoolisées, souvent pour lutter contre le froid de la belle étoile. Le randonneur moyen ne vit pas que de dénivelées et d’eau fraîche, quoi qu’on pense, mais de là à trimbaler force litrons dans son sac à dos... Eux, qui voyagent pourtant très léger, se délestent rarement de leur carburant, ou bien seulement selon le principe des vases communicants.
Terje Sinding ne pouvait guère savoir que la déambulation était l’une de mes occupations les plus nécessaires (oui, c’est gênant quand on est censé tapoter d’arrache-mains sur un clavier toute la journée). Il ne pouvait savoir non plus que j’en ai aussi traduit un, de « livre de marcheur ». L’auteur de celui-là se balade de l’Angleterre à l’Australie. Sa recherche est différente. Mais les marcheurs-penseurs qu’ils citent sont souvent les mêmes. En lisant Marcher, je me suis aperçue que son traducteur et moi avions farfouillé dans les mêmes poèmes de Whitman, épluché – en suant à grosses gouttes, en ce qui me concerne – les mêmes pages du journal de Kierkegaard... Mais seul Terje pouvait donner (page 67) cette belle traduction d’un poème en norvégien d’Olav Nygard, Dikt i samling, dont voici un passage :
[…] Pourquoi se hâter
Quand l’éternité chante sa berceuse
Dans le parler des elfes, quand le temps
Du joug si lourd libère les épaules,
Quand tout se meut au rythme de la danse
Sous le feuillage saupoudré d’argent.
Bientôt sortira un nouveau livre d’Espedal : Contre l’art. Connaissant maintenant un peu le bonhomme à travers les pérégrinations de son personnage dans Marcher, ça n’étonne pas vraiment de lui. En attendant, si vous avez autour de vous des déambuleurs, pérégrineurs, vadrouilleurs, randonneurs, marcheurs, ou même des bernacles irréductiblement accrochées à leur rocher, ça leur ferait un joli cadeau, hein ?
Tomas Espedal
Marcher
(ou l’art de mener une vie déréglée et poétique)
Traduit du norvégien par Terje Sinding
Actes Sud, 2012
Photo de couverture
© Dariusz Klimczak
Tiens, la sédentarité des bernacles qui, après tout, même collées à leur rocher ou dans leur baignoire, peuvent contempler le monde elles aussi, me fait penser à cet autre poème, de Blaise Cendrars celui-là. Un autre ami et collègue, Graham Maclachlan y voit plein « de promesses, d’espoirs, d’ivresse de la vie » :
Tu es plus belle que le ciel et la mer (extrait)
Quand tu aimes il faut partir
Quitte ta femme quitte ton enfant
Quitte ton ami quitte ton amie
Quitte ton amante quitte ton amant
Quand tu aimes il faut partir
Le monde est plein de nègres et de négresses
Des femmes des hommes des hommes des femmes
Regarde les beaux magasins
Ce fiacre cet homme cette femme ce fiacre
Et toutes les belles marchandises
II y a l’air il y a le vent
Les montagnes l’eau le ciel la terre
Les enfants les animaux
Les plantes et le charbon de terre
Apprends à vendre à acheter à revendre
Donne prends donne prends
Quand tu aimes il faut savoir
Chanter courir manger boire
Siffler
Et apprendre à travailler
Quand tu aimes il faut partir
Ne larmoie pas en souriant
Ne te niche pas entre deux seins
Respire marche pars va-t’en
Je prends mon bain et je regarde
Je vois la bouche que je connais
La main la jambe l’œil
Je prends mon bain et je regarde
Le monde entier est toujours là
La vie pleine de choses surprenantes…
Feuilles de route, 1924.
Gallimard 1993
Merci à Terje, à Louis-Paul et à Graham.
Au fond, bloguer, c’est marcher un peu, puisque ça permet aussi de faire des rencontres ou de mieux connaître ceux qu'on a déjà rencontrés.
***
La sculpture L'Homme qui marche, d'Alberto Giacometti, est celle de la fondation Maeght. La photo est l'œuvre de Louis-Paul Fallot. Je l'ai trouvée en farfouillant pour illustrer mon billet et il m'a gentiment autorisée à la publier. Elle s'intitule L'Homme qui marche et l'enfant. Vous la verrez sur cette page du Blog de Louis-Paul.
Elle est chouette, hein ?
Visitez ce blog, les autres photos sont magnifiques aussi.
Des photos comme on aimerait en faire :(
00:06 Publié dans Ceci n'est (vraiment) pas d'la critique littéraire | Commentaires (2) | Lien permanent